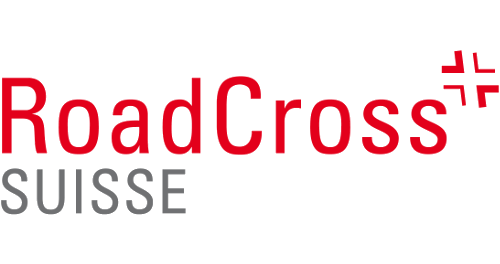« Ce jugement est beaucoup trop clément. C’est injuste ! »
« L’équitable, tout en étant juste, n’est pas ce que prescrit la loi, mais un correctif de ce qui est légalement juste. »
(Aristote, env. 350 av. J.-C.)
Cette citation d’Aristote met en évidence le fait que la justice représente bien plus qu’une simple application de règles. Dans cette optique, les jugements devraient chercher à prendre en compte les circonstances et conditions individuelles pour que la décision adoptée soit juste et proportionnée. Au fond, la justice consiste à traiter chaque individu de manière équitable.
Les lois assurent un certain ordre, sans pour autant garantir que les jugements soient perçus comme justes par toutes les personnes concernées.
C’est précisément là que réside le défi : ce qui paraît juste pour les uns peut sembler inacceptable ou insuffisant pour les autres. Les jugements suscitent rarement un sentiment unanime, car à l’aspect légal s’ajoutent des attentes morales, sociétales et émotionnelles. Par ailleurs, la couverture médiatique influence aussi la manière dont un jugement est perçu. Alors que la justice repose sur des bases légales et sur des peines visant notamment la prévention ou la réinsertion, de nombreuses personnes attendent d’une sanction qu’elle corresponde à leur propre conception de la justice. Cette tension entre une application objective du droit et une perception subjective de la justice est au cœur de nombreux débats, et reflète le désir humain d’être traité non seulement conformément à la loi, mais aussi avec équité.
En tant que victime, il peut être particulièrement pénible et éprouvant de devoir affronter un jugement qui ne correspond pas à ses attentes ou espoirs et qui est perçu comme injuste. Vous trouverez ci-dessous quelques réflexions qui pourraient vous être utiles si un sentiment d’injustice prédomine après une décision de justice.
Décision de justice vs sentiment de justice
Dans les jugements concernant des infractions routières, la notion de justice au sens moral ainsi que la réparation de la souffrance des victimes (notamment en cas de dommages corporels ou de décès) ne constituent pas l’élément principal. La peine est déterminée par plusieurs facteurs, parmi lesquels la violation de dispositions légales spécifiques occupe une place centrale. Sont également pris en compte les causes de l’accident (comme l’inattention, la vitesse excessive, la consommation d’alcool ou de drogues, la négligence grave), les déclarations de toutes les parties impliquées, le rapport de police (incluant photos, conditions de circulation et dommages matériels) ainsi que d’éventuelles infractions antérieures de la personne accusée.
Le sentiment personnel et émotionnel de justice peut fortement diverger de la peine requise. Il est important d’être conscient de cet écart avant d’envisager d’autres démarches. La pertinence de faire appel d’un jugement ou d’une ordonnance pénale dépend de la situation. Par ailleurs, il convient de tenir compte des éventuels frais de justice, des honoraires d’avocat ainsi que d’autres dépenses.
Nous vous recommandons de consulter un avocat spécialisé ou de prendre contact avec notre service de conseil pour une première évaluation afin de déterminer si un recours est pertinent.
En cas de sentiment d’injustice, les questions suivantes peuvent soutenir une réflexion personnelle :
- En tant que victime, quels sentiments et quelles pensées suscitent en moi la décision de justice / la peine infligée à l’auteur ?
- Quels sentiments me traversent en ce moment ?
- Est-ce que je peux gérer ces émotions moi-même ou est-ce qu’il me serait bénéfique de demander une aide ciblée ?
- Est-ce que le fait d’en parler à quelqu’un (famille, amis, connaissances) ou à un spécialiste (thérapeute ou psychologue, etc.) peut m’aider ?
Pistes à explorer si vous avez le sentiment qu’une décision de justice est injuste :
- Demander un conseil juridique : il peut être utile de consulter un avocat spécialisé, qui vous expliquera les voies possibles et les risques juridiques. Il pourra vous aider à comprendre les raisons du jugement et à évaluer s’il existe des chances de pouvoir le contester.
- Faire appel de la décision : dans de nombreux cas, vous avez le droit de faire appel d’un jugement, sous réserve d’un délai à respecter. Il est important de connaître les procédures et conditions exactes.
- Rassembler des preuves : si vous avez l’impression que le jugement repose sur des informations incomplètes ou erronées, il peut être utile de rassembler des preuves supplémentaires ou des témoignages qui soutiennent votre position.
- Soutien émotionnel : partager vos sentiments avec vos amis, votre famille ou un thérapeute peut se révéler bénéfique. Un jugement perçu comme injuste peut être très difficile à gérer sur le plan émotionnel. Nous vous aidons volontiers à trouver un thérapeute ou une approche thérapeutique appropriée.
- Chercher de la visibilité : dans certains cas, il peut être utile de rendre le sujet public – que ce soit par le biais des médias ou des réseaux sociaux – afin d’attirer l’attention sur d’éventuelles injustices. Cela doit toutefois être fait avec circonspection et discernement, tout en tenant compte des conséquences juridiques.
Il est important que vous ne vous sentiez pas seul.e et que vous receviez le soutien nécessaire. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette période difficile et pour vous fournir les informations dont vous avez besoin.
Nous disposons d’un vaste réseau d’avocats spécialisés et expérimentés, et nous nous ferons un plaisir d’établir le premier contact si cela est possible et indiqué.